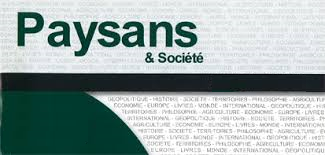
Télécharger le PDF
La filière sucre traverse une crise aigüe. Elle dispose pourtant d’atouts pour la surmonter.
La fin des quotas sucriers, le 1er octobre 2017, laisse un goût amer pour les planteurs de betteraves. Tête de rotation intéressante et surtout composante stable du revenu des polyculteurs d’une grande partie de la moitié nord de la France, la culture de la betterave aura été le pivot agronomique et économique de nombreuses fermes pendant cinq décennies. Fruit d’un progrès technique continu depuis la révolution de la graine monogerme et d’une organisation commune de marché basée sur des quotas de production et un prix d’intervention élevé depuis 1968, l’essor de cette production a également permis aux producteurs d’intégrer progressivement la transformation jusqu’à concentrer environ 90 % des capacités de transformation dans deux coopératives et une filiale d’une coopérative allemande.
La production de sucre est une industrie lourde
La fermeture de plusieurs usines à l’issue de la campagne 2019/2020 constitue la manifestation d’un secteur en crise, contraint de se replier sur les territoires les plus propices afin de faire face à des pertes importantes. Directement connecté au marché international depuis la suppression du régime des quotas, l’avenir de la filière sucrière européenne est des plus incertains. Considérer que cette production est vouée à disparaître pour laisser place aux importations brésiliennes, comme on l’entend parfois, n’est pas sérieux tant cette filière dispose d’atouts importants notamment avec le développement des énergies renouvelables comme l’éthanol. L’argument de la sécurité des approvisionnements doit également être invoqué, surtout dans un contexte de dérèglement climatique, même si le prix des matières premières dans le budget des ménages européens ne pèse plus très lourd.
Pour autant, il serait illusoire de croire que le seul jeu des intérêts individuels permettra de dessiner l’avenir de la filière sucrière. La production de sucre est une industrie lourde : une usine doit tourner au moins cinq mois pour écraser ses coûts fixes. La principale erreur serait de croire qu’en ajustant les surfaces d’une année sur l’autre, les producteurs s’en sortiront mieux. Au contraire cela irait de mal en pis pour l’ensemble de la chaîne. A l’inverse, la place prépondérante des coopératives sera une chance pour le secteur, si chacun prend conscience de la dépendance réciproque dans laquelle il se situe de manière à induire des comportements de coopération et non du chacun pour soi. Aussi, pour assurer davantage de cohésion dans cette dépendance réciproque, un nouveau projet politique doit être redéfini par les acteurs de la filière et porté auprès des pouvoirs publics pour disposer du soutien nécessaire au nom de l’intérêt général. A défaut de reconstruire cet horizon commun, les dissensions se multiplieront rendant impossible la réalisation des petits sacrifices individuels nécessaires pour affronter la tempête et sauver l’embarcation commune.
Afin d’initier cette réflexion, il est nécessaire de partir d’un diagnostic partagé. Nous proposons ici d’identifier les principaux termes de la discussion.
La réforme de 2006 était une bonne réforme
La filière sucrière européenne était restée relativement préservée du mouvement de réforme de la Pac observé à partir de 1992 jusqu’à ce que le Brésil sonne la charge contre la politique sucrière européenne en saisissant l’OMC en 2003. Le premier exportateur mondial de sucre reprochait à l’UE son système de double quota l’assimilant à une forme de subvention à l’exportation en faveur de la production hors quotas. L’UE a ainsi été tenue de plafonner ses exportations à 1,35 million de tonnes (Mt) alors même que les volumes exportés dépassaient les 5 Mt et que l’on venait de donner un accès illimité au marché communautaire aux Pays les moins avancés (PMA).
Pour tenir cet engagement, la réforme de 2006 a été enclenchée. Elle constitue un changement complet de logique dans la régulation du secteur sucrier européen où, jusqu’alors, ce sont les exportations qui constituaient la variable d’ajustement pour stabiliser le marché intérieur. Afin d’ajuster le marché intérieur les quotas sont maintenus mais réduits de plus de 6 Mt en trois ans, sur une base volontaire et incitative.
Le prix minimum européen du sucre est abaissé de 36 % pour atteindre 404,4 euros par tonne, et en compensation, les producteurs reçoivent une aide découplée couvrant 60 % de la baisse de prix qui sera directement intégrée dans leur Droit au paiement unique (DPU). Le niveau des quotas ayant été établi en fonction des besoins alimentaires européens, une production hors quotas était permise mais les sucriers devaient faire la preuve de disposer des débouchés suffisants. La production hors quotas recouvrait les exportations de sucre mais aussi la production d’alcool et d’éthanol.
De plus, en cas de tension sur le marché du sucre européen, une part de la production hors quotas pouvait être requalifiée en production sous quotas. Cette disposition a notamment été utilisée en 2011. Inversement, la Commission disposait de la faculté d’ajuster à la baisse le volume sous quotas de manière à maintenir l’équilibre du marché, y compris en cas d’importations trop importantes. La réforme de 2006 a eu les effets escomptés : l’UE est devenue importatrice nette de sucre et le prix international a connu une évolution favorable jusqu’à rejoindre les prix européens en 2010.
La suppression des quotas n’a pas été imposée par l’OMC
En amont de la réforme de la Pac de 2013, dès 2011, la Commission prépara les esprits à une suppression des quotas à peine réformés. L’argument principal était que le sucre devait connaître la même évolution que les autres productions, l’abandon des quotas laitiers ayant été décidé en 2008. Pour la Commission, c’était le moyen de disposer d’une « monnaie d’échange » supplémentaire dans les négociations internationales. En supprimant les quotas, la Mesure générale de soutien (MGS) de l’UE allait être réduite. Mais, compte tenu du blocage du cycle de Doha en 2008 et sur fond de crise alimentaire mondiale, cette « monnaie d’échange » n’avait aucune valeur et n’a intéressé personne. Face à la volatilité des marchés internationaux et aux risques d’insécurité alimentaire, la dynamique qui prévalait s’est inversée et la plupart des grands pays producteurs ont renforcé leurs politiques agricoles.
Il convient également de rappeler que l’époque était à l’euphorie pour la quasi-totalité des productions, le « discours des neuf milliards de bouches à nourrir en 2050 » battait son plein. L’offre alimentaire n’allait pas pouvoir suivre une demande croissante, le problème des pénuries allait définitivement remplacer celui de la surproduction et les prix internationaux allaient rester élevés. La fin des quotas sucriers fut ainsi actée lors de la réforme de la Pac de juin 2013 alors que le prix du sucre sur le marché européen était à son plus haut niveau dépassant les 700 euros/t. Deux années plus tard, il était redescendu à un peu plus de 400 euros/t.
En définitive, la suppression des quotas n’a pas été imposée par l’OMC. Pour la Commission européenne, la fin des quotas sucriers était le moyen de poursuivre le programme de dérégulation, alors même que l’épisode de flambée des prix de 2007/08 et le blocage du cycle de Doha qui s’en est suivi nécessitait une inflexion qui n’est pas encore advenue. Le démantèlement de ces outils de régulation du marché européen du sucre n’aura pas fait que des perdants : la compétitivité de l’agro-alimentaire a été améliorée, l’industrie européenne peut maintenant se fournir en sucre au prix le plus bas. Il aura donc fallu attendre fin 2017 pour connaitre le grand vainqueur de la réforme de la Pac de 2013 : c’est Coca-cola qui avec des achats de 1 Mt de sucre sur le territoire européen peut maintenant acheter à 300 euros/t contre 700 euros/t en 2013, soit un bénéfice de 400 millions d’euros par an !
Les outils privés de gestion des risques inefficaces face au dumping.
La suppression des quotas et du prix d’intervention ont conduit à connecter le marché intérieur avec les échanges internationaux. En théorie, le prix international du sucre doit correspondre aux coûts de production des producteurs les moins compétitifs mais néanmoins nécessaire pour satisfaire l’ensemble de la demande. Dans la vraie vie, le prix international est le plus souvent un prix de dumping dans la mesure où il traduit la volonté du pays le plus compétitif de gagner des parts de marché à l’exportation et exploiter au maximum son front pionnier. C’est le cas du sucre avec le Brésil, premier producteur et premier exportateur mondial. Ainsi, outre épisode de tension provoquée par un incident climatique ou un phénomène de spéculation, les prix internationaux sont stables et à un niveau inférieur aux coûts de production de la plupart des producteurs. Cette situation peut durer d’autant plus longtemps que si l’offre s’ajuste très vite face à des prix hauts, c’est nettement moins le cas à la baisse compte tenu des importants coûts fixes mobilisés : l’agriculture est une industrie lourde !
Dans ces conditions, les outils privés de gestion des risques économiques sont d’un faible secours. En effet, le risque de marché est systémique, il touche tous les producteurs en même temps, rendant impossible la mutualisation. Les contrats d’assurance sont eux-mêmes établis en fonction de l’évolution des marchés à terme : si ces derniers sont déprimés, le niveau de prix garanti par l’assurance sera lui-même bas.
Enfin, la perspective d’utiliser un « instrument de stabilisation des revenus » lors de réforme de 2013, sorte de fonds de mutualisation contre les risques de marchés, a fait chou blanc. Aucun pays n’a réussi à mettre en place cet instrument ! Comment en effet penser que des acteurs économiques pourraient aller lever de l’argent sur les marchés financiers sur la base d’une mise initiale d’argent public afin de constituer un fonds qui servirait à verser des équivalents subventions aux agriculteurs … qu’ils auraient à rembourser par la suite ? Parmi les nombreuses conditions à réunir l’une d’entre elles parait d’autant plus hors d’atteinte : comment disposer d’un fort niveau d’engagement et de cohésion parmi les membres du fonds alors même que cette solution est promue au nom de la supériorité des approches privées et individuelles sur celles publiques et collectives ?
Le marché mondial du sucre n’existe pas. La formule peut surprendre, tant elle est intégrée dans les raisonnements. Pourtant, l’examen des marchés intérieurs des principaux pays producteurs le démontre : mise à part l’UE, tous les autres grands pays producteurs se protègent contre le prix des exportations brésiliennes qui constitue de facto le prix international. Dans ces conditions, les perspectives pour la production sucrière européenne ne sont pas des plus réjouissantes si ce n’est qu’avec des droits de douanes à plus de 300 euros/t, le marché européen se redéconnectera du marché international quand l’UE sera devenue importatrice y compris en intégrant les multiples contingents tarifaires à droits nuls. Cela correspondrait à une baisse de la production européenne de l’ordre d’environ 30 %.
L’éthanol pour reconstruire une politique sucrière européenne
Comme pour les céréales, la relation entre le niveau des prix et le ratio stocks de fin de campagne/consommation est forte. Pour le sucre, tout se passe comme si avec des stocks de soudure de l’équivalent de quatre mois de consommation, c’était la panique, alors même qu’à six mois d’équivalent de consommation, les stocks semblent déborder et les prix au plus bas. On peut donc avancer qu’avec un volant stabilisateur d’un mois de consommation, on puisse éviter les emballements et les longues déprimes. Et traduit en biocarburant, ce mois de consommation de sucre représenterait 0,34 % de la consommation annuelle de pétrole !
La production de biocarburants rendue flexible peut tout à fait jouer le rôle de stabilisateur des marchés internationaux dès lors qu’une diplomatie sera établie entre les principaux pays producteurs comme le Brésil qui ajuste, de longue date, le taux d’incorporation de l’éthanol dans les carburants. Alors que la filière européenne des biocarburants s’est développée dans les années 1990 sur la base de la jachère, il est indispensable de retrouver une cohérence entre la politique agricole et la politique énergétique afin de réhabiliter les biocarburants de première génération. Utiliser les biocarburants pour stabiliser les marchés agricoles et alimentaires serait favorable à la sécurité alimentaire mondiale car la faim dans le monde est davantage imputable à des problèmes de prix instables et/ou bas qu’à des prix élevés.
En définitive, la filière sucrière européenne est en danger et un diagnostic partagé de la situation tarde à venir. Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur les responsabilités qui ont conduit à cette crise, mais il est indispensable de renouer la discussion et de s’engager dans la construction d’un nouveau projet politique. Cette filière a montré par le passé qu’elle avait été en mesure de relever des défis importants, puisse la génération actuelle relever celui-ci. ■
Frédéric Courleux, Directeur des études d’Agriculture Stratégies











